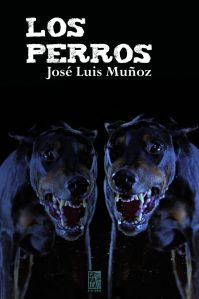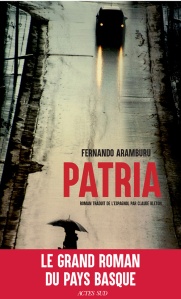Fortement inspiré de l’histoire même de l’auteur, ce roman raconte l’histoire de Saul Cheval Indien, jeune indien Ojibwé.
Son enfance est déjà oblitérée par le système avant même qu’il intègre le pensionnat indien de St Jérôme en 1961, à l’âge de 8 ans. Ses parents sont des « survivants » de ces pensionnats.
« Ce spectre se voyait chez d’autres adultes, mon père, ma tante et mon oncle. Mais c’est chez ma mère que sa présence nous effrayait le plus.
– « Le pensionnat, chuchotait-elle dans ces moments-là. Le pensionnat. » »
Sa mère s’était à ce point repliée sur elle-même que, « pour le monde extérieur, elle cessait parfois d’exister. »
Une fille, Rachel, leur ayant déjà été enlevée pour un de ces pensionnats, les parents emmènent Saul et son frère ainé Benjamin dans la forêt, vers le « lac de Dieu », pour vivre de la terre avec un oncle et leur grand-mère.
« Keewatin. C’est le nom du vent du nord. Les Anciens lui donnaient un nom parce qu’ils voyaient en lui un être vivant, une créature comme les autres. Le Keewatin prend naissance à la lisière des terres sans arbres et serre le monde entre ses doigts cruels, nés dans le sein glacé du pôle Nord. Le monde ralentit peu à peu son rythme afin que les ours et les autres créatures qui hibernent remarquent l’inexorable progression du temps. Cette année-là, cependant, le froid est descendu rapidement, à la façon d’une gifle, soudaine et vengeresse. »
En dépit de toutes leurs précautions, Benjamin finit par être enlevé et conduit au pensionnat. Quelques années plus tard, il s’en échappe pour venir retrouver les siens mais, malade de la tuberculose, il meurt peu de temps après.
Saul, se retrouve seul dans les bois avec sa grand-mère, après le départ de ses parents, pour une brève parenthèse de bonheur, qui prendra fin lorsque la vieille femme meurt de froid. Livré à lui-même, Saul est envoyé à St Jérôme.
« … Là, à l’abri, ma grand-mère aurait trouvé un moyen de me garder près d’elle. À la place, elle était partie. Morte de froid pour me sauver. Et je suis à mon tour parti à la dérive sur une nouvelle et étrange rivière. »
Saint-Jérôme était une institution religieuse dédiée non pas à aider les enfants, mais à les formater en s’efforçant de couper tous les liens les rattachant encore à leur indianité, et les convertir à la langue et à la religion des «Zhaunagush», les hommes blancs. Il leur était interdit de parler leur langue, sous peine de sévères punitions. Les élèves en ressortaient brisés, certains acculés au suicide.
Dans cet enfer, l’espoir viendra pour Saul par la personne du père Leboutilier, un jeune prêtre qui entraîne l’équipe de hockey. Saul va révéler des possibilités étonnantes pour ce sport, une technique de patinage hors du commun, et une vision instinctive du jeu, quasiment surnaturelle. Son obstination et sa volonté de progresser pour maîtriser son art peuvent lui laisser espérer l’accès aux ligues majeures.
Il sera bien vite confronté au racisme, aux insultes, et au refus des blancs de laisser les indiens s’approprier ce qu’ils considèrent comme LEUR sport. Il finira par abandonner le hockey, qui était devenu sa raison de vivre, pour partir dans une longue errance à travers le pays.
La prose de Wagamese, d’une grande force d’évocation, nous plonge dans la culture amérindienne et les paysages glacés du Nord, où l’homme est en relation étroite avec la nature. Des bancs du pensionnat jusque sur la glace des patinoires, il nous fait ressentir avec force les humiliations subies par Saul, et au-delà par les Indiens en général.
Richard Wagamese a beaucoup écrit sur l’impact terrible qu’ont eu ces écoles sur leurs anciens élèves, la douleur et les blessures endurées par les victimes, qu’elles transmettent souvent à leurs propres enfants. Les parents de l’auteur ont eux-mêmes survécu au système scolaire du pensionnat, mais en sont sortis tellement abîmés par les abus dont ils ont été témoins et qu’ils ont subis, qu’ils n’ont pas été capables d’élever eux-mêmes leur fils.
Les dommages causés par ces pensionnats aux jeunes indiens qui les ont fréquentés, et qui y ont survécu, sont absolument terrifiants. Dans la bouche de Saul, ils représentaient « l’enfer sur terre ». Ils sont la résultante d’un système qui avait pour but de gommer toute leur identité indienne.
Dans ce roman, sombre et émouvant, à mi-chemin entre récit initiatique et chronique sociale, Richard Wagamese s’attaque de front à cet héritage, faisant revivre de manière très réaliste, et en même temps empreinte d’une grande sensibilité, un pensionnat indien d’une nature difficilement imaginable dans la deuxième moitié du XXème siècle.
Peuplé de personnages forts et vrais, c’est également un implacable réquisitoire sur un racisme institutionnalisé, à une époque pas si lointaine, mais aussi, selon les propres mots de l’auteur, un roman sur « la rédemption, la guérison et l’espoir ». Dans le même temps, c’est une célébration enthousiaste du sport national canadien.
Un excellent moment de lecture, je recommande chaudement…
Éditions ZOÉ, septembre 2017
Éditions XYZ, sous le titre « Cheval Indien », 2017
4ème de couv:
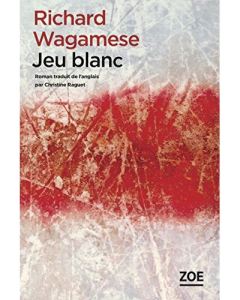 Voici l’histoire de Saul Indian Horse, un jeune Ojibwé qui a grandi en symbiose avec la nature, au cœur du Canada. Lorsqu’à huit ans il se retrouve séparé de sa famille, le garçon est placé dans un internat par des Blancs. Dans cet enfer voué à arracher aux enfants toute leur indianité, Saul trouve son salut dans le hockey sur glace. Joueur surdoué, il entame une carrière parmi les meilleurs du pays. Mais c’est sans compter le racisme qui règne dans le Canada des 70’s, jusque sur la patinoire. On retrouve dans Jeu blanc toute la force de Richard Wagamese : puisant dans le nature writing et sublimant le sport national canadien, il raconte l’identité indienne dans toute sa complexité, riche de légendes, mais profondément meurtrie.
Voici l’histoire de Saul Indian Horse, un jeune Ojibwé qui a grandi en symbiose avec la nature, au cœur du Canada. Lorsqu’à huit ans il se retrouve séparé de sa famille, le garçon est placé dans un internat par des Blancs. Dans cet enfer voué à arracher aux enfants toute leur indianité, Saul trouve son salut dans le hockey sur glace. Joueur surdoué, il entame une carrière parmi les meilleurs du pays. Mais c’est sans compter le racisme qui règne dans le Canada des 70’s, jusque sur la patinoire. On retrouve dans Jeu blanc toute la force de Richard Wagamese : puisant dans le nature writing et sublimant le sport national canadien, il raconte l’identité indienne dans toute sa complexité, riche de légendes, mais profondément meurtrie.
L’auteur:
Richard Wagamese (1955-2017) est l’un des principaux écrivains indigènes canadiens. Appartenant à la Nation des Ojibwés, originaires du nord-ouest de l’Ontario, il est devenu en 1991 le premier lauréat amérindien d’un prix de journalisme national et a été régulièrement récompensé pour ses travaux journalistiques et littéraires. Après Les Étoiles s’éteignent à l’aube, Jeu blanc (paru au Canada en 2012) est son deuxième roman traduit en français, et est fortement inspiré de sa propre histoire.




 Hugo Nicollini est un garçon différent des autres gamins de son âge. Un père brutal. Une maman protectrice. Un soir, il est témoin d’une dispute entre ses parents. Une de plus. Une de trop. Cette fois-ci, sa mère succombera sous la violence des coups.
Hugo Nicollini est un garçon différent des autres gamins de son âge. Un père brutal. Une maman protectrice. Un soir, il est témoin d’une dispute entre ses parents. Une de plus. Une de trop. Cette fois-ci, sa mère succombera sous la violence des coups. Dans les années quarante, en Louisiane, Jefferson, un jeune noir, démuni et ignorant, est accusé d’un crime qu’il n’a pas commis : l’assassinat d’un Blanc. Au cours du procès, il est bafoué et traité comme un animal par son propre avocat commis d’office devant la cour et, pour finir, condamné à mort. La marraine de ce jeune homme décide alors que ce dernier doit, par une mort digne, démentir ces propos méprisants. Elle supplie l’instituteur, Grant Wiggins, de prendre en charge l’éducation de Jefferson. Le face à face entre les deux hommes, que seule unit la couleur de peau, commence alors…
Dans les années quarante, en Louisiane, Jefferson, un jeune noir, démuni et ignorant, est accusé d’un crime qu’il n’a pas commis : l’assassinat d’un Blanc. Au cours du procès, il est bafoué et traité comme un animal par son propre avocat commis d’office devant la cour et, pour finir, condamné à mort. La marraine de ce jeune homme décide alors que ce dernier doit, par une mort digne, démentir ces propos méprisants. Elle supplie l’instituteur, Grant Wiggins, de prendre en charge l’éducation de Jefferson. Le face à face entre les deux hommes, que seule unit la couleur de peau, commence alors…